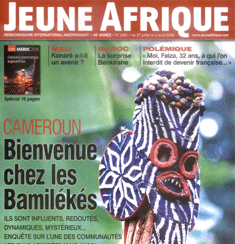 Jeune Afrique fait un reportage sur les bamilékés au Cameroun
Jeune Afrique fait un reportage sur les bamilékés au Cameroun
Patrice Towa a acheté un exemplaire de la dernière édition de Jeune Afrique hier à Yaoundé. " Je me demandais s’ils n’avaient point repris la campagne qui mettait à l’index une prétendue volonté bamiléké de prendre le pouvoir, comme au début des années 1990. " Patrice a donc été quelque peu déçu. Pourtant, le grand reportage de J.A. promettait de satisfaire son lecteur en donnant à comprendre et à découvrir les Bamilékés, " l’une des communautés les plus admirées mais aussi les plus controversées d’Afrique centrale ".
C’est du moins ce à quoi le grand reportage dans le jargon des journalistes renvoie en général. Mais de la page 22 du magazine franco-africain qui a consacré six pages à la question, comme à la fin du reportage, on peut se demander pourquoi les Bamiléké, au-delà des fantasmes nourris au sujet de cette communauté, ont intéressé Jeune Afrique. Le journal répond tout de suite, pour éviter la polémique sur un sujet sensible : après les Berbères, les Touaregs, auparavant mis en exergue " voici donc les Bamis ". Il y en aura d’autres, promet l’hebdo.
En attendant Dioulas, Peuls ou Zoulous, J.A. nous apprend que Bamiléké signifierait les " gens nombreux " en medumba, langue des Bangangté fort répandue dans le département du Ndé dans la province de l’Ouest. Pour autant, les Bamilékés ne font pas indistinctement foule puisqu’ils préfèrent se présenter sous l’étiquette de leur chefferie d’origine. Tous, selon J.A., ne se reconnaîtraient pas sous le nom Bamiléké et ne parlent pas la même langue. S’ils partagent l’attachement à leurs villages d’origine, aux tontines, et un sens du business, ce n’est pas cela qui en fait une communauté controversée.
Le journal relève plutôt que ce sont des gens friands de terres. Les achètent-ils ou les extorquent-ils ? J.A. ne répond pas à une question aussi polémique que l’idée reçue du dynamisme exclusif des " Bamis ". Pire, le reportage met en opposition les Duala et les Bassa. Les premiers se seraient laissés envahir tandis que les seconds résistent aux envahisseurs. " Ils sont minoritaires dans la Sanaga-Maritime, et, même s’ils épousent nos femmes, leurs enfants mâles n’auront pas nos terres, sauf s’ils renient leur clan paternel ", écrit Jeune Afrique.
Détournements
Pour ne pas laisser le lecteur friand d’affrontements tribaux, marque distinctive supposée du continent en Occident, sur sa faim, J.A. lui suggère une explication à cette méfiance qui a constitué, ailleurs, le terreau de massacres inter-ethniques. Un témoin anonyme, comme la majorité des personnes citées dans ce reportage, déclare qu’ " il y avait des tribus chouchoutées des colons et des tribus honnies, tels les Bamilékés, qui ont lutté farouchement pour l’indépendance. On nous a appris à nous méfier d’eux. " On, dont parle Benoît, qui est-il ? Quel leader indépendantiste camerounais s’est-il réclamé du “Bami land” ?
Au fil des lignes, on en apprend encore sur la controverse que susciteraient les Bamiléké, à défaut de passer en revue quelques unes des figures de l’élite intellectuelle, du monde des affaires, ou de la politique. Et c’est peut-être là que l’on peut lier l’invitation au voyage chez les " Bamis " à l’actualité camerounaise. Le bal des têtes d’affiche est ouvert par les Fotso, père et fils. Yves-Michel, le fils de Victor, a récemment été entendu par la justice dans l’Affaire Albatros, souligne J.A. Sans plus. L’Albatros n’est-elle pas l’affaire qui secoue les fondements du landernau politico-financier camerounais ? L’on ne s’arrêtera point sur la question, tant le reportage avait déjà fait comprendre au lecteur que parmi ceux qui font l’objet de détournements de deniers publics, l’on ne compte point beaucoup de Bamilékés.
Et, quand on ajoute que J.A. pense qu’il vaut mieux aujourd’hui " rétablir la moralité à tous les niveaux, y compris dans les affaires ", au lieu de " diaboliser les Bamilékés " sans lesquels " le pays ne décollera pas ", l’on peut se demander de quels Bamilékés parle le journal.
Parions que Josiane, qui se lamentait déjà de la souillure portée par les ministres et personnalités bamilékés dans les lieux sacrés des chefferies, ne sera pas trop mécontente de voir l’assainissement de la gestion des fonds publics frapper quelques uns de ses " frères ". Mais qu’en diront " les André Sohaing, Joseph Kadji Defosso et autres Victor Fotso" qui " tirèrent leur réussite " d’une " alliance " avec " le président Ahidjo, qui, au début des années 1960, encouragea la formation d’une bourgeoisie dans cette communautés en échange de l’abandon des luttes dans les maquis de l’Upc " ?
Source: Quotidien Mutations
|