Lorsqu'il s'agit de poser le débat sur le délabrement social et économique du Cameroun et de l'Afrique en général, une majorité de personnes s'accorde à dire que pour amorcer tout processus de développement, un « changement de mentalité » s'avère nécessaire voire primordial. Si on ne peut remettre en cause l'impérieuse nécessité de modifier nos structures mentales, attachons nous d'abord à comprendre ce qui peut en constituer le cadre général fondateur.
De manière relativement simple, la « mentalité » peut se définir comme un ensemble des paradigmes de la conscience qui déterminent plus ou moins comment, devant une situation donnée, telle personne ou tel collectif serait amené à réagir. C'est notre manière de penser ou d'interpréter les choses, notre lecture du monde. C'est une sorte de cadre psychologique déterministe de notre pensée (et donc des nos actions) devant les situations de la vie qui se présentent. Par ailleurs, la mentalité reste fortement liée à la culture et aux moeurs en vogue dans la société dans laquelle nous évoluons et, à quelques choses près, elle peut résolument s'y confondre.
Partant de cette définition et de ce rapport fusionnel entre culture et mentalité, il nous paraît aisé d'affirmer qu'on ne pourra penser efficacement l'Afrique de demain que si on tourne définitivement le dos à certains des acquis culturels et des programmes mentaux qui accompagné notre quotidien depuis plusieurs siècles.
L'Afrique doit résolument entrer dans une phase de révolution de ses moeurs si elle veut nourrir l'espoir de sortir du gouffre dans lequel elle semble être embourbée. Il n'y a clairement aucune perspective heureuse pour un développement économique et technologique sur le continent sans le préalable d'une renaissance culturelle. Non pas qu'il faille changer la culture africaine : ce qui serait irréaliste comme objectif. Mais, il est impératif de la remodeler, de l'ajuster et, tout en lui permettant de garder ses points forts, ce qui fait sa spécificité, de lui permettre de rester en phase avec les bouleversements techniques, économiques et sociétaux du monde d'aujourd'hui. L'Afrique a donc inévitablement besoin de se bâtir, pour reprendre l'expression d'un auteur Camerounais, « un programme d'ajustement culturel ».(1)
Il nous est apparu pertinent de nous arrêter sur trois points fondamentaux qui ne prétendent pas être exhaustifs mais déterminent néanmoins, à un certain degré, aujourd'hui, la façon de vivre de l'africain moyen et constituent des freins à l'éveil du continent. Les deux premiers éléments que nous aborderons, à n'en pas douter, sont le résultat d'un « héritage culturel » ancestral qui tend à vouloir perdurer et qui, dans sa globalité, n'est pas totalement adapté aux impératifs de la modernité et ses corollaires. Le dernier point, ayant trait à l'irrationalité de la pratique des concepts religieux (particularisme non typiquement africain puisque sévissant dans d'autres pays pauvres), s'est aussi, au delà de sa perspective historique et culturelle, considérablement accentué à cause d'une misère galopante de manière spectaculaire, d'une incertitude sociale profonde et d'un climat de paranoïa politique de tout instant.
Du culte de la tribu
 Femmes d'une tribu Camerounaise : quand on réussit, on doit nourrir toute une communauté
Femmes d'une tribu Camerounaise : quand on réussit, on doit nourrir toute une communauté
L'Afrique ne cessera de nous surprendre. C'est le seul continent où l'individu ne peut s'épanouir en tant que personnalité sociale qu'à travers une famille élargie et plus globalement, à travers la tribu dont il est originaire. L'individu est ainsi effacé pour laisser place au clan, à une communauté. Babacar Ndiaye, ancien président de la BAD, posait déjà bien le débat en ces termes quand il demandait, dans une interview à un quotidien américain :
« Nous avons en Afrique une notion très étendue de la structure familiale.C'est très bien d'un point de vue humain(...) (Mais), comment insérer dans le développement une personne qui doit avec son maigre salaire s'occuper de dix ou vingt personnes ? » (2)
C'est une question qui mérite, effectivement, toute notre attention. Si on ne peut nier ce côté solidaire et humaniste qui prévaut dans cette façon de vivre foncièrement commun(autar)iste, il convient quand même de s'inquiéter quant au bien fondé de ce genre de pratiques sur la durée, surtout quand elles s'inscrivent dans une logique de dépendance totale et durable du pauvre envers celui qui a professionnellement réussi, en lieu et place d'un système permettant aux plus démunis de gagner en autonomie pour générer leurs propres revenus. Ce qui n'était alors qu'une culture plutôt positive de la solidarité se transforme inévitablement en éloge de la facilité.
La priorité devient alors, pour cet individu intellectuellement apte et financièrement capable d'être un acteur à part entière du développement de son pays, non plus de s'atteler à améliorer le devenir de ses concitoyens dans leur globalité, mais plutôt, de ne pas faillir à sa mission d'assistant social de son clan. De cette manière, il ne brise pas les règles du jeu tribal qui veulent que si l'individu se réalise un minimum socialement, il devient le garant du bien être d'une petite communauté qui doit nécessairement en profiter, d'une quelconque manière, même au détriment de l'intérêt national. Ces pratiques se manifestent, dans le cas des responsables politiques ou des chefs d'entreprise, par des ministères ou des sociétés aux allures de petits villages déportés en plein centre ville. Assistants, plantons, secrétaires particuliers, etc. et une pléiade de postes clés portent alors les stigmates de la tribu dont est originaire le « grand patron ».
Peut-on espérer apporter des changements cruciaux et constructifs majeurs dans notre pays quand la constitution des acteurs, responsables politiques, dirigeants, chefs d'entreprise, se fait non pas sur la base des compétences intrinsèques, mais, essentiellement sur des critères patronymiques et linguistiques liés au canton dont on est originaire ?
Cette question n'appelle objectivement qu'à une réponse négative.
Du culte du « grand frère »
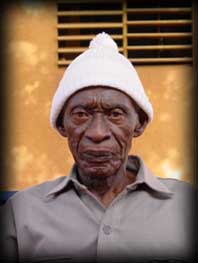 Au Cameroun, un total respect est dû aux anciens : ils ont toujours raison
Au Cameroun, un total respect est dû aux anciens : ils ont toujours raison
Là encore est un autre travers africain. Ce que l'on a appelle ici le culte du grand frère est cette propension que les Africains ont à faire acte d'allégeance à leurs aînés en toutes circonstances tout en continuant de croire que, respect et liberté d'expression sont antinomiques.
Si dans le cadre familial, pour le petit garçon de 15 ans, ne pas intervenir dans un débat entre deux aînés malgré le fait qu'il ait éventuellement une opinion pertinente et constructive peut sembler normal et préférable, dans le cadre professionnel, ce genre d'attitudes peut s'avérer être une entrave à l'expression profonde de la liberté d'expression, et donc de la contradiction. Et finalement, à des perspectives de solutions optimales à des problématiques concrètes. En effet, comment espérer arpenter le chemin du progrès si le débat contradictoire et la remise en question ne sont pas autorisés pour des prétextes aussi ridicules que celui de l'âge de l'intervenant ?
Sur ce point précis, l'occident fait montre justement d'une plus grande largesse d'esprit. Les scènes où on verrait de jeunes garçons dire à leurs parents leurs quatre vérités sur un ton qui leur vaudrait une fessée mémorable en Afrique y sont d'une banalité des plus triviales. D'ailleurs, il n'est pas exclu qu'à l'issue de la dite altercation, le parent aille adresser ses excuses au jeune garçon en lui faisant savoir qu'il avait effectivement vu juste. C'est impensable sur notre continent et pourtant, c'est là même que commence la culture démocratique, la culture du débat contradictoire, la culture de la justice et de l'objectivité. Et, ce qui peut donc paraître comme de l'impertinence pour le cas du jeune homme occidental devant ses parents devient alors un atout dans la vie professionnelle et dans l'exercice des choix politiques : "c'est du choc des idées que jaillit la lumière", disait l'adage. Et, continuer a annihiler le débat contradictoire sous prétexte qu'une personne n'aurait pas droit à la parole du fait de son âge civil, politique ou entreprenarial, contribue à perpétuer les concepts de « père de la nation » ainsi que des modèles de vie vieillots, statiques et inadaptables au monde qui évolue profondément.
Combien de jeunes diplômés n'ont pas fait savoir leurs frustrations lorsque, rentrant au pays et évoluant dans des entreprises de la place, ils n'ont pu démontrer leurs savoir faire acquis à l'étranger en déployant des idées innovantes sous prétexte que, de vieux cadres génération « années 60 » n'en voyaient pour le moins du monde l'utilité tout en les taxant de jeunes arrogants ?
Question pour laquelle nous n'avons, au fond, aucune statistique, mais qui, en elle-même, reste symptomatique de la problématique des « brimades » intellectuelles liées à l'âge au sein de la société Camerounaise et africaine en général.
Du culte de l'irrationnel
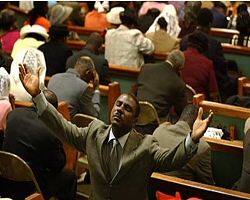 La réligion est devenue pire que l'opium du peuple au Cameroun
La réligion est devenue pire que l'opium du peuple au Cameroun
Si Marx aimait à dire que la religion est l'opium du peuple, il est clair qu'au regard de l'Afrique d'aujourd'hui, cette phrase serait un doux euphémisme et, ce serait sans mal, que le philosophe allemand se retournerait dans sa tombe. En effet, sur le continent africain, l'irrationnel est devenue la chose la mieux partagée et la plus vulgarisée qui soit. L'irrationnel explique tout.
A travers marabouts, fétiches, églises de réveil et sectes en tout genre, l'africain projette hors de lui sa véritable essence et se perd dans un monde illusoire qu'il a lui même créé mais qui finit par le dominer comme une puissance étrangère. En guise de compensation à la misère et aux conditions de vie toujours plus difficiles, il se réfugie finalement dans ce qu'un philosophe aimait à appeler la « réalité fantastique du ciel ». Nous n'avons pas encore compris que même si la spiritualité constitue d'une certaine manière le volant de nos vies, nous gardons malgré tout la maîtrise du dit volant et partant de là, nous demeurons les principaux responsables des choix directionnels qui seront faits dans nos existences.
Aujourd'hui, le Camerounais moyen nage dans un vaste océan d'irrationnel. Plus rien ne peut s'expliquer par des raisons naturelles. Tout est mystique. D'une simple maladie à une nomination à un poste quelconque, tout est soit bénédiction du Seigneur, soit fétichisme, soit maraboutisme ou d'autres choses encore. Les églises en tout genre se forment et ont pignon sur rue sans que cela n'interpelle réellement les pouvoirs publics. Entre les prédicateurs qui prétendent réaliser des miracles par la toute puissance de Dieu et les petits marabouts de quartier aux pouvoirs innombrables qui peuvent guérir les maladies les plus complexes à base de quelques potions magiques, il est clair que le Cameroun est définitivement aux prises avec la superstition.
Le pire, c'est que, les hommes politiques ou ceux qui constituent l'élite de ce pays se font aussi les victimes de ce genre de pratiques. Aucune couche sociale n'échappe à la montée de l'irrationnel et de la superstition. Et finalement, de se poser la question de savoir comment une société peut-elle prétendre à se développer quand, dans sa globalité, elle continue de rêver et de croire en l'hypothétique arrivée d'un « Jésus Christ socio-économique » qui apportera développement, modernité et prospérité ?
(1) L'Afrique a-t-elle besoin d'un programme d'ajustement culturel?, Daniel Etounga Manguelle, L'Harmattan
(2) Babacar Ndiaye, interview accordée au New York Times
Note de la rédaction : Article publié pour la première fois en 2006.
|